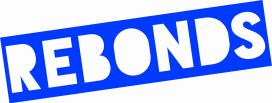Passée notre phase d’enquête sur les changements de paradigme du développement économique, nous avons abordé depuis septembre les terrains des tests, de Lille à Montpellier en passant par Figeac, Rennes ou Grenoble. Comment ré-outiller les équipes de développement économiques pour toucher les entreprises les moins dotées pour faire face aux enjeux de transition ? S’équiper pour porter des stratégies d’implantation des entreprises plus cohérentes avec les besoins écologiques et sociaux du territoire ? Peut-on repenser les coopérations inter-territoriales à partir des vulnérabilités d’un territoire ? Quel est le profil du développeur ou de la développeuse économique de demain… Voici un petit aperçu des premières expérimentations sur les rails dans le cadre de Rebonds.
Pour piloter l’implantation des entreprises, les critères écologiques et sociaux ne suffisent pas…
Si le développement d’outils comme l’éco-conditionnalité des aides vise à privilégier l’implantation d’entreprises plus conscientes de leur responsabilité territoriale, en pratique la seule instruction des projets d’implantation à la lumière de critères écologiques et sociaux ne suffit pas : les activités économiques génèrent des nuisances écologiques difficiles à mesurer, les emplois créés ne correspondent pas toujours au profil de la main d’oeuvre locale, les nouvelles implantations peuvent accroître la pression sur les services publics, le logement, etc. Quelles pistes pour porter plus fortement l’ambition dans ce domaine ?
La métropole de Montpellier a mis en place une grille d’évaluation écologique et sociale de l’implantation des entreprises. Cependant son usage demeure interne et n’associe pas les entreprises, et le processus d’implantation actuel ne permet pas une mesure fiable ni l’accompagnement des entreprises dans la prise en compte de leur impact écologique et sociale sur la durée. Nous faisons l’hypothèse que des améliorations passeront par un processus d’apprentissage plus collectif, associant directement les entreprises et partant davantage de leurs réalités, de celles de l’administration et des élu.e.s.
Ce que l’on va tester : Une grille d’évaluation d’implantation avec des critères sociaux et environnementaux prototypes et testée auprès d’entreprises « complices », afin de mieux qualifier les projets d’implantation sur ces enjeux sociaux et environnementaux pour mieux accompagner les entreprises.
Expérimenter de nouvelles modalités d’accompagnement des TPE-PME dans les transitions écologiques, s’appuyant sur des cabinets d’expertise comptable
Les équipes du développement économique peinent à toucher et mobiliser les TPE-PME dans des démarches de transition faute de connaissance et d’accès à ces entreprises d’une part, de disponibilités de leurs dirigeant.e.s d’autre part. Ces entreprises sont pourtant particulièrement vulnérables et souvent en manque d’ingénierie pour s’adapter. Les acteurs « intermédiaires » proches des TPE-PME que sont les expert.e.s-comptables, les banques, les cabinets d’assurance, etc. seraient-ils en mesure de repérer, conseiller et accompagner leurs clients qui en ont besoin dans leur trajectoire de transition et développer ainsi une nouvelle offre de conseil sur la transition ?
Aujourd’hui, les équipes de développement économique comme celles des métropoles de Grenoble et Rennes n’ont pas de contact direct avec ces acteurs « intermédiaires », et ces derniers connaissent mal les dispositifs d’aide et d’accompagnement aux transitions développées par les collectivités, dont leurs clients pourraient bénéficier. Nous faisons l’hypothèse qu’avec une meilleure connaissance des dispositifs, et à travers un dialogue avec les équipes de développement économique, les expert.e.s-comptables pourraient intégrer dans leurs prestations un service de conseil/relais sur les sujets de transition et favoriser ainsi le passage à l’acte des TPE-PME (rénovation énergétique de leurs bâtiments, décarbonation de leurs mobilités, adaptation de leur modèle d’affaires, etc.) Et qu’en retour, cela permettra à la collectivité de mieux adapter son offre d’accompagnement aux besoins des TPE-PME.
Ce que l’on va expérimenter : des modalités d’appropriation par 3 à 4 cabinets d’expertise-comptable, avec l’appui de l’équipe de développement économique, des dispositifs de soutien à la transition des entreprises qui leur paraissent les plus pertinents, et le test de leur intégration dans leurs prestations auprès de quelques-unes de de leurs clientes TPE-PME.
Faire un meilleur usage de la recherche pour des politiques de développement économique mieux concertées et prenant mieux en compte les vulnérabilités d’un territoire
Comment repenser la politique de développement économique d’un territoire, notamment au regard de ses dépendances aux ressources ? A quelles conditions ces vulnérabilités et inter-dépendances peuvent-elles offrir un point de départ pour initier des coopérations entre territoires ? Comment outiller la collaboration entre action publique et recherche scientifique afin que la celle-ci soit mieux utile aux agents et élus ?
Le programme de recherche ReSyst explore les modèles de développement économique des territoire et les flux matériels et immatériels qui les sous-tendent et les relient, avec l’hypothèse qu’une meilleure connaissance de ces flux aiderait les acteurs publics et privés locaux à accroître la résilience économique de leur territoire, dans un contexte de transition écologique.
Dans le cadre de Rebonds, avec le PETR Figeac Vallée de Dordogne, on saisit l’opportunité de ReSyst pour s’interroger sur la manière dont des données objectivant les interdépendances entre territoires pourraient aider les élu.e.s à engager le dialogue et des coopérations, dans un contexte où la vision du développement économique reste, sur le territoire, assez dispersée et où peu de coopération existent, autour de la gestion de ressources en tension comme l’eau ou le bois par exemple.
Ce que l’on va tester : Comment passer du diagnostic à l’action ? Nous dessinons pour cela deux expérimentations :
- un outil de débat à destination des acteurs, élu.e.s et agents publics locaux pour embrasser les controverses qui émergent du diagnostic, et ainsi accompagner son appropriation, dépasser les « faits » présentés pour se saisir des tensions qu’ils soulèvent, et les points à arbitrer pour avancer collectivement.
- Un kit d’accueil et de formation à destination des futur.e.s élu.e.s, sous la forme d’une série de conversations / micro-enquêtes permettant d’actualiser en continu et d’incarner le diagnostic avec des expériences d’acteurs locaux, et de former les nouveaux élu.e.s en incarnant le diagnostic par des exemple de terrain.
Construire les compétences du développeur ou de la développeuse économique de demain
Si les équipes de développement économique sont souvent peuplées de moutons à 5 pattes, elles se heurtent aujourd’hui, pêle-mêle, au manque d’effets de leurs outils traditionnels sur un grand nombre d’entreprises, à la disparition de certains leviers de leurs actions comme le foncier, aux écueils d’une politique menée en silos lorsqu’elle aurait besoin d’une vision ‘grand angle’ et de perspectives stratégiques, …
Le Cnam, Intercommunalités de France et l’ANCT lancent une nouvelle formation Développeur économique territorial. En 6 sessions, il s’agit d’outiller ses ces agents aux profils très divers pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui. Dans le cadre de Rebonds, il s’agira d’apporter une dimension expérimentale, pour contribuer à renforcer son adéquation aux défis et besoins des participants et de leur collectivité, au prisme d’enjeux de transition écologique et de justice sociale.
Ce que l’on va expérimenter : En prenant comme point de départ les enseignements de la phase d’enquête de Rebonds, nous aimerions co-construire et tester, avec les participants et l’équipe pédagogique, une grille de montée en maturité des développeurs économique.
Négocier les usages du foncier
Les collectivités, en particulier les Métropoles, sont aujourd’hui confrontées à une raréfaction du foncier disponible sur leur territoire, qui conduit à une concurrence exacerbée entre ses différents usages possibles. Ce qui est perçu aujourd’hui comme un frein au développement économique pourrait être pensé au contraire comme une opportunité pour faire un meilleur usage du foncier, plus sobre (notamment en ressources naturelles), plus coopératif, et répondant mieux aux besoins et enjeux du territoire et de ses habitant.e.s.
Plusieurs situations récentes ont fait prendre conscience à la métropole européenne de Lille du besoin de plus de coordination entre services de la MEL (développement économique, habitat, énergie, mobilité, etc.) sur l’usage des (derniers) fonciers disponibles. Quelle modalité de négociation, de dialogue et de coordination faudrait-il instituer pour promouvoir une vision plus transversale et intégrée ? Comment instaurer une vigilance mutuelle des services sur les synergies possibles, pour optimiser l’usage du foncier ?
Ce que l’on va expérimenter : Un atelier pour « rejouer » avec les services concernés le processus d’arbitrage qui a eu lieu récemment sur le devenir d’une friche, et produire un cahier des charges commun pour optimiser le foncier et préfigurer uneinstance de dialogue pour l’usage futur des fonciers MEL.